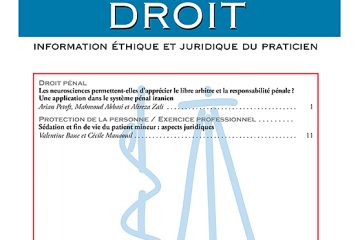Par Jean-Jacques Wunenburger, Professeur émérite de philosophie
La catastrophe du covid19 témoigne globalement de la fragilité et de la vulnérabilité des grandes formes dominantes de la rationalité systémique de la modernité et de la mondialisation. Un grain de sable a fait s’écrouler le château de cartes du prométhéisme moderne. Comme un effet papillon, le virus, présumé provenir d’un animal en Chine, a fait s’effondrer de vastes pans de l’infrastructure matérielle et institutionnelle des sociétés occidentales (quel avenir pour les compagnies aériennes, pour les compagnies de spectacle, pour l’Europe, pour l’OMC ?). Nos sociétés hyper techniques ont pu se doter d’armements sophistiqués (nucléaires), envoyer des robots dans le système solaire, fabriquer des objets par imprimantes 3D, mais vaciller d’un seul coup parce qu’elles ne parviennent pas à se protéger d’une épidémie, pourtant endémique sous d’autres formes, etc. En revenant sur l’enchainement des acteurs et des faits, on ne peut s’empêcher de penser que la version dramatique de l’épidémie relève moins d’un destin, d’une fatalité, d’une tragédie donc, que d’une série de choix humains, souvent inadaptés ou contre productifs, au point d’en devenir parfois absurdes.
En effet,
- Comment est-il possible que les acteurs sanitaires –et politiques– aient paru si démunis, si surpris, devant ce qui est arrivé ? Alors que les scénarios de changement climatique donnent lieu à tant de spéculations et modélisations à l’échelle de décennies futures, presque personne (quelques contre-exemples retentissants sont restés dans les tiroirs des ministères), n’a pu prévoir les risques immédiats sur la santé des contemporains (et non des générations futures) ? La montée du niveau de la mer est mieux anticipée et combattue que des menaces immédiates mais tangibles ? À l’inverse de l’adage célèbre, on a sans doute, à force de regarder la lune, oublié de regarder le doigt (gangrené…).
- Fallait-il placer l’histoire de l’épidémie dans un décor de guerre (en France), faisant entrer dans l’intrigue les arsenaux, les combats, le théâtre de lutte, le profil robot de l’ennemi ? Ou ne pouvait-on pas placer l’intrigue dans un climat plus irénique, plus intériorisé, plus confiant, comme l’a fait le chancelier allemand qui préférait invoquer la responsabilité citoyenne sous le signe d’un « devoir d’humanité » ? Certes la théâtralisation guerrière (d’un président amateur de théâtre, et admirateur de grands hommes), légitimait une « mobilisation » sanitaire, mais au prix d’un climat profondément anxiogène, comme toute guerre, surtout lorsqu’elle n’est pas réservée à des professionnels comme aujourd’hui ?
- Comment l’imaginaire de l’infection-contagion, qui sert de matrice à toutes les peurs ancestrales et qui alimente les conduites les plus obscures, a-t-il pu gagner si vite les esprits et réussir à faire confiner la population comme jamais (qu’on aurait pu attendre après une sévère contamination radio-active et qui n’a même pas été utilisée après Tchernobyl et Fukushima) ? Alors que nos sociétés riches se gargarisent du triomphe de la rationalité, elles se retrouvent brutalement sous le coup de la panique, laissant remonter à la surface les défiances et méfiances à l’égard de l’autre, les tentations de délations, les stéréotypes de bouc émissaires, les interprétations nébuleuses de l’épidémie comme signes et châtiment divin ?
- L’ampleur disproportionnée de l’épidémie, faute de réponses adaptées, ne trahit-elle pas à notre époque un règne nouveau de l’émotion (aucune épidémie n’avait entrainé une telle mobilisation collective) et une peur inédite devant la mort ? Mort qu’on a d’ailleurs, au même moment, rendu invisible, déritualisée, désocialisée, froide pour les proches, au nom de la précaution sanitaire ? Nos contemporains ont beau voir chaque soir sur leur écran des cadavres, crimes, salles d’opération (très en vogue), jamais ils n’ont en fait eu tant de peine à les voir en face.
- Comment les acteurs de la science biomédicale ont-ils pu la faire tomber de son piédestal en laissant des experts plus ou moins charismatiques et compétents, engager des controverses dévastatrices pour l’opinion ? Alors que la fracture entre biomédecine et médecines alternatives est déjà grande (avec des positions intolérantes, des condamnations parfois dignes de la chasse aux sorcières), l‘arène hautement médiatisée des étiologies et des choix thérapeutiques ne s’est-elle pas trouvée rapidement privée de sérénité, de confraternité professionnelle et de prudence scientifique ?
- Corollairement, n’a-t-on pas, une fois la « guerre » déclarée au virus, laissé trop de responsabilité politique aux généraux, c’est-à-dire aux soldats en blanc, en leur confiant la tâche non seulement de soigner mais d’organiser la société en vue du soin ? Va-t-on généraliser et légitimer dorénavant cette entrée en scène ? Serait-ce réaliste de penser que pour éviter la situation critique des hôpitaux, on va pouvoir interdire la guerre (belle utopie sans doute), interdire l’automobile, qui coûte en plus si cher à la sécurité sociale, etc. ? Tirer de la médecine d’urgence, inévitablement exposée à des surcharges et échecs, une politique générale de la santé, n’est-ce pas subordonner la société à la médecine et non la médecine à la société, cédant ainsi à une « bio-politique » tant dénoncée depuis des décennies ? N’a-t-on pas perdu de vue que si le confinement diminuait l’afflux de malades et des risques accrus de décès, il était sans doute aussi source de retards dans les soins d’autres pathologies non liées au virus, de perturbations psychiques chez les confinés, de détresse psychosociale liée à l’effondrement du monde du travail ? A-t-on assez pris en compte l’accroissement de l’inégalité d’accès aux soins ? A-t-on assez mis en balance des bénéfices/risques, instrument pourtant privilégié de toute situation de risques ?
- Comment l’impuissance à assurer le suivi des malades et les soins urgents, surtout de ceux qui sont confinés dans les hospices EHPAD, dont la comptabilité mortifère a été utilisée de manière spectaculaire, a-t-elle fini par servir de miroir cruel au délaissement de la classe d’âge la plus nombreuse (suite à l’allongement de la vie) et gardienne des liens intergénérationnels ? Comment une société qui valorise tant la jeunesse (dans les affaires et la politique) au détriment des personnes âgées peut-elle vraiment faire place, après cela, à une gérontologie humaine, de plus en plus urgente pour le respect et la dignité de la personne ?
- Enfin, comment la montée en puissance de la santé publique, sur fond de révolution numérique généralisée, de téléconsultation, du recours aux « big data », d’outils numériques de traçage, etc., va-t-elle sauvegarder et redévelopper les acquis de l’éthique du prendre soin individuel (care), née de l’expérience humanisée du face-à-face entre soigné et soignant, sur fond d’une expérience de la vie menacée, fragilisée ? Comment garantir la liberté individuelle, assurer la protection de la vie privée devant tant de dispositifs statistiques et algorithmiques si nous transférons (et pas seulement déléguons) à l’État un pouvoir discrétionnaire de gérer les populations, au nom d’un bien commun sacrificiel et toujours suspect d’intérêts particuliers ?
Jean-Jacques Wunenburger
Professeur émérite de philosophie
Membre du bureau de l’Espace éthique azuréen (CHU de Nice)
Ce texte est extrait d’un article à paraître en septembre aux Éditions du Cerf dans un ouvrage collectif dirigé par Emmanuel Hirsch, consacré à l’épidémie.