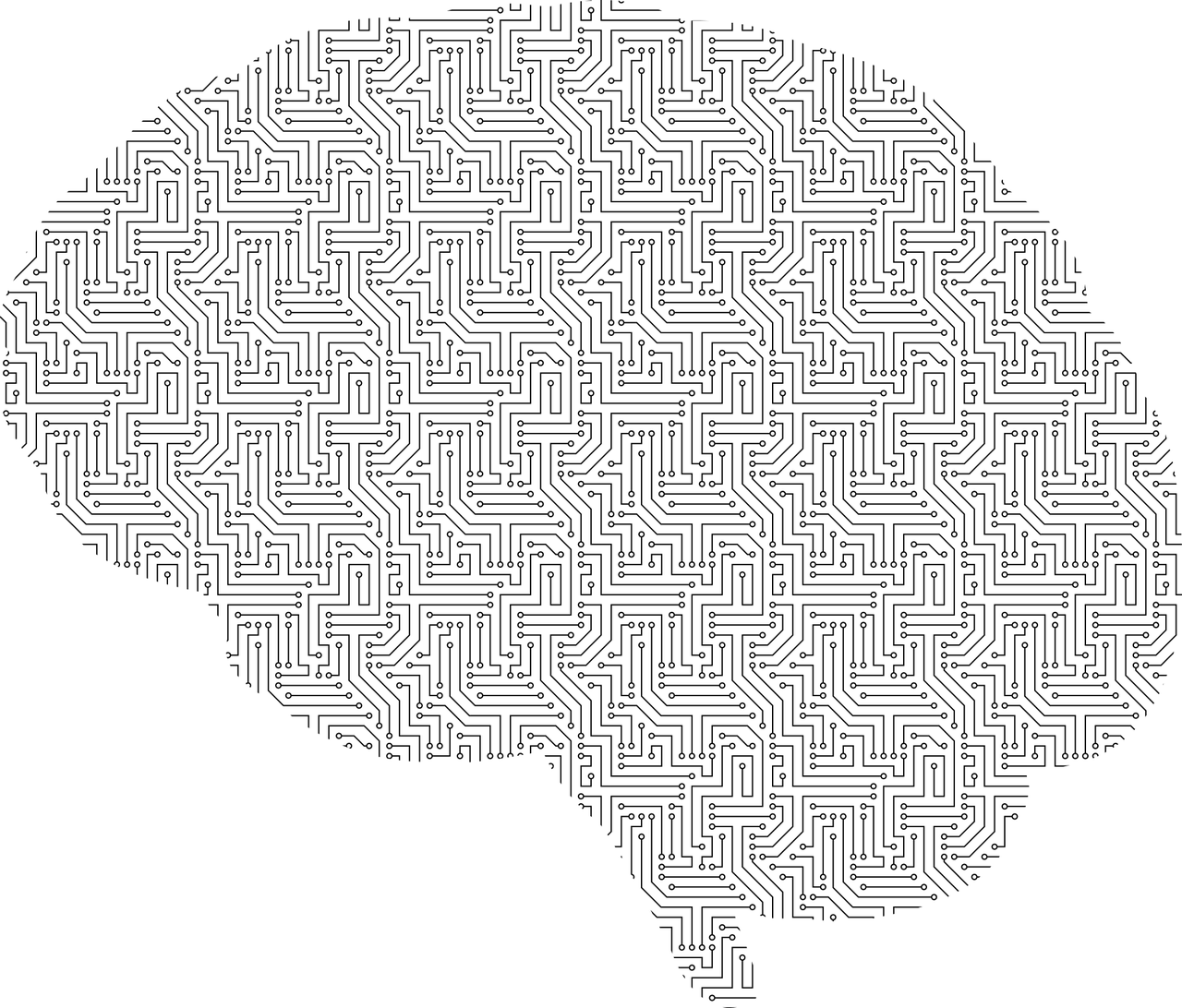IA en santé: accélération technologique mais vigilance humaine
Le nouveau rapport de l’OMS sur l’intelligence artificielle en santé* dresse un constat sans appel: l’Europe avance vite, mais souvent sans gouvernail. Les usages explosent, les outils se perfectionnent… alors même que les stratégies, les cadres juridiques et la formation des soignants peinent à suivre le rythme. Seulement 8% des États disposent d’une stratégie dédiée à l’IA en santé. Les autres naviguent à l’estime, sans cap ni vision réelle, jouant des coups souvent par opportunités.
Mais cette accélération mal contrôlée comporte des risques éthiques majeurs.
D’abord, l’érosion du jugement clinique. Lorsque des outils d’aide au diagnostic, de triage ou de prédiction deviennent omniprésents, la tentation de faire aveuglement confiance à la machine est grande. Sans formation solide intégrant la nécessaire compréhension des limites des outils, l’IA devient alors le tuteur envahissant qui sournoisement risque d’affaiblir le discernement humain. Le soignant se retrouvant en position d’«exécutant augmenté», au lieu d’être l’agent moral qu’il doit demeurer.
Ensuite, l’autonomie du patient fragilisée par l’opacité des systèmes. Le rapport montre que les citoyens et les associations de patients sont très peu associés aux réflexions qui président au développement des outils. Si l’IA influence de plus en plus les décisions médicales, comment garantir que la volonté du patient reste première et intelligible par l’algorithme? Comment fera-t-il valoir ses choix, ses valeurs et ses préférences vis-à-vis d’une entité imperméable «by design» à toute considération subjective?
Vient aussi la question cruciale des inégalités. L’OMS démontre que l’Europe se fracture: certains pays disposent d’infrastructures numériques robustes, de hubs de données, d’équipes formées et de financements dédiés… tandis que d’autres accumulent retards et vulnérabilités. Si rien n’est fait, l’IA deviendra un nouvel accélérateur d’injustices: entre territoires dotés et déserts technologiques, entre patients-geeks ultraconnectés et laissés-pour-compte du numérique (illectronisme), entre ceux dont les données sont bien représentées et ceux dont les profils n’ont encore nourri aucun algorithme. La solidarité numérique est en passe de devenir une nouvelle exigence éthique.
Enfin, un risque plus silencieux traverse l’ensemble du rapport: la fragilisation de la relation de soin. À mesure que des systèmes automatisés s’interposent entre soignant et patient, le risque est réel de voir se fragiliser cette relation de confiance, d’écoute et de présence, la seule qui, in fine, donne réellement le sentiment d’avoir été correctement prise en charge.
Il n’est pas question de contester l’immense potentiel de l’IA au service du soin mais plutôt de pointer une évidence: l’innovation doit rester une alliée sans jamais devenir le substitut de l’humain. Cultivons ensemble cette vigilance éthique, indispensable pour préserver la qualité du jugement clinique, garantir les intérêts légitimes du patient et maintenir vivante cette relation singulière qui fait du soin autre chose qu’un processus technique.
Pr Gilles Bernardin