Par Aurélie Calzia, soignante médico-technique au CHU de Nice
Début 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 frappe à nos portes et ferme les frontières. Un virus contagieux, invisible, pernicieux. Début mars 2020, quelques tests commencent à être réalisés en routine au laboratoire de virologie. Il n’y a pas d’organisation spécifique, pas d’espace, pas de bras supplémentaire, la mise en place se fait en catastrophe. Je vais aller au front, nous sommes en guerre.
On nous a dit: témoignez, racontez, écrivez ce que vous avez vécu. La crise sanitaire, les couloirs de l’hôpital, la fatigue, l’urgence, les masques, les tests, la peur.
Mais rien n’est venu.
L’ahurissement, puis la pression et l’anxiété, ensuite la lassitude, et enfin le désarroi. Le découragement. Le fond du trou, parfois. Les rires aussi.
Au début de l’année 2020, j’ai vaguement entendu parler du coronavirus, en Chine, mais je n’ai pas pris cette histoire au sérieux. J’ai pensé à un coup médiatique, à du sensationnel journalistique. En février, j’ai fait un stage de danse, je suis allée au carnaval de Nice, j’ai acheté un billet d’avion pour Montréal, pour un voyage prévu en avril.
Quand le carnaval de Nice a été interrompu, j’ai pensé que cela n’était pas approprié, que la décision était démesurée. Je n’avais pas compris.
Le 2 mars, une table ronde autour du Covid-19 est organisée au CHU de Nice avec un médecin hygiéniste, un médecin infectiologue, la directrice de la coordination générale des soins et un médecin du travail. Le discours est plutôt rassurant, on nous rappelle les règles d’hygiène de base à respecter: lavage des mains essentiellement. À ce moment-là, le port du masque n’est recommandé qu’en cas de symptômes respiratoires.
Au laboratoire de virologie, la tension monte progressivement. Le coronavirus va t-il déferler sur la France aussi? Faudra t-il effectuer des tests?
Fin février, c’est le branle-bas de combat pour tous les Centres Hospitaliers de France : le Centre National de Référence partage ce diagnostic virologique tout nouveau.
Pour réaliser les tests, il faut avoir non seulement les ressources humaines mais aussi les kits, le matériel. La commande est immense et internationale, tout le monde a besoin des mêmes produits au même moment: l’approvisionnement ne suit pas. Puis, il faut mettre au point la technique, toute nouvelle, sans recul, à adapter pour une pratique en routine.
Troisième semaine de février, des discussions à propos de la mise en place de la PCR Covid-19 vont bon train au laboratoire de virologie. Les kits du Centre National de Référence sont attendus la semaine suivante, pour les tester et les adapter. On en parle, mais il n’y a pas vraiment de perspective dans le temps, c’est plutôt une hypothèse de courte durée. L’ampleur que cela va prendre n’est pas anticipée. Et comment est-ce que cela aurait été possible?
O, I, E, L et A* s’y collent: quelques jours de mise au point sont nécessaires pour tester et ajuster le protocole technique sur site. Dernier week-end de février, des volontaires du service de virologie reviennent pour commencer à réaliser les PCR. Première semaine de mars, quelques tests commencent à être faits en routine. Il n’y a pas d’organisation spécifique, pas d’espace, pas de bras supplémentaire, la mise en place se fait en catastrophe.
À ce moment-là, il n’y a pas de masque, pas de distanciation sociale.
En technique, les prélèvements sont d’abord préparés manuellement, c’est à dire aliquotage et lyse des échantillons en protéinase K sous hotte. Ensuite transfert en navettes et lyse cellulaire sous hotte, puis passage sur l’automate d’extraction. Puis, on récupère un par un les éluats dans des tubes nunc, on prépare un mix dans un bac de glace dans une pièce dédiée, puis on dépose les éluats patients un par un dans une plaque PCR 96 puits. On filme la plaque et on lance la PCR sur le thermocycleur.
Début mars, de passage au laboratoire de virologie pour un audit dans le service mitoyen, la chef de service me lance dans le couloir: « Si tu as envie de venir nous donner un coup de main, on t’accueille! » Je lui réponds: « S’il y a besoin, oui je viens! » Elle paraît légèrement surprise et marque un temps d’arrêt: « Sérieusement? » « Oui oui bien sûr, appelle-moi! »
Je sors de là en espérant presque être rappelée, car la virologie, ce sont quatorze années pendant lesquelles j’ai énormément appris, partagé, ri, noué de solides amitiés, pu mener mes projets professionnels et personnels avec encouragements et bienveillance: j’en suis extrêmement reconnaissante. Je ne refuserai jamais d’aider ce service, qui est comme une famille pour moi.
Une semaine plus tard, la discussion est mise sur la table sérieusement, en réunion de cadres. Je suis rappelée, le personnel présent ne suffit plus, il faut plus de bras, augmenter l’amplitude horaire, ouvrir sept jours sur sept.
La demande est croissante, la pression monte, l’Italie, voisine, est débordée par les malades et les décès sont importants. Je comprends alors que les hôpitaux font sans doute déjà du tri, qu’on tente de sauver qui peut.
Le débat sur l’approvisionnement en masques bat son plein en France, puisqu’il n’y a pas de masques. On nous a dit que ça ne servait à rien, aujourd’hui c’est devenu indispensable. Mais apparemment, il n’y a pas de stock.
À l’hôpital, le plan blanc est déclenché le 14 mars. Depuis fin février, on reçoit des messages nous indiquant la conduite à tenir si l’on revient de Chine, puis de certaines régions d’Italie, de Singapour, de Corée du sud, d’Iran: les messages se succèdent et la liste des territoires désignés comme « à risque » s’allonge. Il ne faut pas se présenter au travail et rester 14 jours chez soi, puis seulement en cas de symptômes, puis il faut venir quand-même: le message n’est plus vraiment clair, on est tous perdus.
Vendredi 13 mars, je vais voir la cadre du laboratoire de virologie, j’ai besoin de tenues de labo car je n’ai plus que deux blouses à manches longues au vu de mes fonctions actuelles d’ingénieur. F me prête deux pantalons pour commencer, je prendrai plus tard les pantalons d’une cadre, d’une collègue, je me débrouillerai. Je ressors des chaussures de courses à pied que je dédie au labo. La cadre me donne le planning pour la semaine suivante. Je serai officiellement détachée pour quelques semaines, le temps que ça se calme. Finalement je resterai dans le service jusqu’au 3 juillet.
Ce week-end là, je vais dans le Var voir mes parents, on discute de ce qui est en train d’arriver, on ne comprend pas. Je reçois un sms d’un de mes voisins, qui a des symptômes typiques: quelques jours plus tard, il perd le goût et l’odorat. Il s’en sortira sans trop de séquelles, avec une fatigue persistante pendant plusieurs semaines.
Dimanche 15 mars, le président de la République annonce le confinement dès le mardi 17 mars à midi. « Nous sommes en guerre ». Incrédule, je me dis qu’il exagère, que le terme est choquant, que les gens qui ont vécu la guerre vont être offusqués. Je crois que cela ne va pas durer, tout au plus quelques semaines et on n’en parlera plus. Je me souviens de l’épidémie de grippe H1N1 l’hiver 2009-2010, il y avait eu un peu d’agitation aussi, quelques samedis travaillés, puis tout était retombé. Je m’attends au même scénario. Mais tout de même, les frontières se ferment, et j’ai un voyage prévu au Canada le 10 avril, pour rendre visite à mon compagnon parti en janvier: l’angoisse me prend. Je vais aller au front, je ne peux pas être au meilleur endroit pour lutter.
On nous a réuni sur la terrasse devant le laboratoire, réunion d’organisation, comme on peut, comme on pourra, en extérieur, à 1 mètre les uns des autres, sans masque.
On nous dit que d’autres personnels seront rappelés en renfort: on rapatrie les techniciens du pôle de biologie qui font de la biologie moléculaire, qui seront formés et opérationnels plus rapidement.
On nous dit aussi qu’on s’attend à 20% de personnel touché par le Covid-19, de surveiller l’apparition de symptômes et de fièvre, mais de venir travailler quand-même.
Je suis abasourdie, je me demande ce qui va vraiment se passer. Je pense à mon compagnon au Canada, au voyage prévu dans quatre semaines… Je serre les dents.
Un appel à l’aide a été lancé par mail, techniciens, médecins, secrétaires et ASH sont demandés pour venir aider l’équipe du laboratoire de virologie.
On n’a pas de masque, sauf dans l’enceinte L3, où il y a des FFP2: à utiliser avec parcimonie, selon les approvisionnements, il ne faut pas gaspiller. C’est dans le L3 que les échantillons seront ouverts et préparés avant extraction, là où sont d’habitude effectuées les techniques de recherche. Il n’y pas les locaux pour le faire ailleurs, et le L3 offre la meilleure protection pour le personnel.
Je regarde mon premier planning « Covid-19 » et mes horaires: je commence le 18 mars, des journées en 8, 9 ou 10H. Au vu de la cadence et des impératifs de rendu de résultats donnés par la Direction Générale de la Santé et l’Agence Régionale de Santé, le laboratoire ouvrira de 7h à minuit 7 jours sur 7 dès le 16 mars.
On nous dit aussi que les plannings évolueront en fonction des agents qui tomberont malades, que les horaires évolueront selon les besoins, en fonction de l’ampleur de la vague.
Dès le premier week-end, je serai de soir, 16h-00h, avec S mon ancien collègue, lui aussi rappelé en renfort.
Je suis plutôt reposée quand je commence, enthousiaste à l’idée d’être utile et d’aider ce service, anxieuse aussi, d’être performante et à la hauteur de la tâche qui m’attend. J’espère ne pas attraper le virus et résister. J’espère arriver à me reposer efficacement, à garder mon attention, ma perspicacité. Je mets en place une hygiène de vie d’athlète en préparation à une compétition: une orange pressée le matin, huiles essentielles une fois par semaine, suffisamment de sommeil, 30 minutes minimum de yoga tous les jours.
Le premier jour, je suis formée par L, puis D et S simultanément. Dès le lendemain je serai autonome, la semaine suivante je formerai de nouveaux techniciens rappelés en renfort.
L’organisation est en plein remaniement, un poste pré-analytique dédié au Covid a été monté en quelques jours, pour gérer l’afflux d’échantillons. S m’impressionne: il est là depuis deux jours et gère l’organisation des prélèvements et des listes de travail, le timing nécessaire pour chaque tâche. Je trouve mes anciens collègues déjà fatigués, ça fait plusieurs semaines que c’est compliqué pour eux, qu’ils ont dû rester plus tard le soir, revenir le week-end, sans repos supplémentaire. Qu’ils reçoivent des consignes qui changent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qu’ils subissent la vague montante de plein fouet. Je sens qu’il y a eu des tensions et je ne cherche pas à connaître les détails. Je me concentre le plus possible et reste calme.
Je n’ai pas techniqué depuis 3 ans mais je me souviens bien des extracteurs, les réflexes sont pris depuis longtemps et reviennent naturellement.
On prépare des bacs de détergent-désinfectant pour y décontaminer les pots de plastique triple emballage dans lesquels arrivent les prélèvements, qu’on rentre et ressort du L3 via un sas. Première paire de gant avant le sas, puis habillage dans le sas: surblouse, surchausses, calot, FFP2. On entre dans le L3, on enfile une deuxième paire de gants. La gestion des échantillons, les ouvrir sous la hotte, vérifier qu’ils n’ont pas coulés, vérifier l’identité des patients, décontaminer sans cesse, gérer les déchets à autoclaver, ok, ça va.
D me dit que le détergent-décontaminant a déjà été récemment en pénurie et qu’on a dû préparer de l’acide chlorhydrique dilué pour décontaminer les surfaces et les pots.
Au début, un contrôle cellulaire était réalisé pour chaque prélèvement, mais très vite ça n’a plus été possible: trop de patients. Il n’y a pas de contrôle interne. Les étapes manuelles sont nombreuses, il ne faut pas se tromper, on a que très peu de moyen de s’en rendre compte, et on ne peut pas toujours recommencer: la responsabilité de la bonne réalisation de la technique est énorme.
Premiers jours, je me déshydrate: l’équipement, en particulier le masque FFP2 porté dans le L3, associé à la sous-pression de cette pièce, les efforts physiques engendrés, je me fais avoir. Au vu des étapes d’habillage et des sas, on ne sort pas avant d’avoir terminé sa série. On va aux toilettes avant ou après, on boit avant ou après. Mais je n’ai pas pensé à boire, et j’ai des maux de tête en fin de journée.
Le FFP2 est épais et serre fort le visage, il me blesse le nez. Les sachets triple emballage sont collés très fortement, on doit tirer énergiquement avec nos mains sur le plastique, on tente de le déchirer comme on peut, on utilise des ciseaux pour s’aider (qui finissent par ne plus couper à force d’être malmenés). Le soir, on a des courbatures dans les épaules, les bras et le dos.
Dans mon lit, après ma journée, je respire et réalise un scanner mental: ai-je mal quelque part? Aurais-je un début de symptôme quelconque?
Je pratique le yoga tous les jours, quels que soient mes horaires. Ça m’aidera énormément à tenir.
B est arrêtée un mois, elle craque. Trop de monde, pas d’espace, la peur de ramener le Covid à la maison. On n’a pas d’information claire sur le niveau de contagiosité, la gravité est inconnue, tous les jours on entend parler des morts. Il n’y a pas de dépistage systématique, la consigne est de rester chez soi en quarantaine 14 jours en cas de symptôme. Et elle a appris en janvier que sa fille était atteinte d’un lymphome.
Dès la fin de la première semaine, L tombe malade: grosse toux, fièvre, courbatures. On l’apprend en arrivant le lundi suivant. Elle a donné les formations à presque tous les techniciens arrivés la semaine précédente. On pense alors qu’on a tous dû être contaminés ensemble. Impuissants, on espère ne pas être trop malade. On n’aura son résultat que le mardi, négatif pour le Covid-19, mais positif pour un autre coronavirus!
On a bientôt des masques mais l’organisation n’est pas au point. Chaque service doit compter le nombre de masques par jour et par agent, en fonction des plannings qu’il faut fournir (et qui changent sans arrêt), des tableaux impossibles à faire par les cadres qui s’arrachent les cheveux. Puis une distribution est organisée au niveau du bureau des entrées, il faut montrer son planning, donner son nom, son service. On aura finalement deux masques par jour et par agent.
Puis c’est au tour de E de tomber malade, dans le courant de la semaine suivante. Nez qui coule, fatigue, comme un rhume. Il a suivi la consigne de venir travailler quand-même. Dans le L3, je travaille avec O, quand C nous annonce nous passer le prélèvement de E dans le passe-plat pour qu’on le teste. On s’observe avec O, stupeur: on va tous l’attraper. On lui fait une PCR et un test rapide multiplex respiratoire. Son prélèvement sort négatif pour tous les virus respiratoires testés.
On apprend que le maire de Nice est positif au Covid-19, qu’il se fait soigner par le Professeur Didier Raoult dont on entend beaucoup parler, qui propose la Chloroquine comme médicament miracle. Des essais cliniques se mettent en place, je vois passer des prélèvements pour des patients inclus dans le protocole DISCOVERY. Suivront d’autres essais, French Covid, Anaconda… Je me moque: pourquoi pas Armageddon?
Une des biologistes est arrêtée une semaine, épuisée physiquement. N arrive un matin pas bien du tout, et je lui fais remarquer qu’elle ne semble pas dans son assiette. Alors elle pleure, elle a peur pour son bébé, elle a peur de lui ramener la maladie, elle a entendu qu’un enfant est décédé en Angleterre. Elle souffre de voir parfois le masque mal porté et cela augmente son angoisse. Un rappel sur le correct port du masque est fait à tous par la cadre.
Un soir avec S, on ressort les bacs de détergent-décontaminant pour les vider dans l’évier. Ils sont lourds, et un des bacs est bloqué dans un support de plastique à roulettes. Je n’arrive pas à le débloquer alors je saisis le tout pour vider le bac coincé, mais le poids s’allégeant au fur et à mesure que le bac se déverse, le support de plastique se débloque, et le seau se renverse à côté de l’évier. Piscine! S évite de peu les éclaboussures et me voilà partie dans un fou rire qui dure un bon quart d’heure. Je ris toute seule en épongeant le liquide au sol. Le fou rire a du mal à passer, j’en pleure même. Je me dis qu’il est le témoin de la tension nerveuse engrangée ces derniers jours.
Le soir, à 20h, des applaudissements se font entendre aux fenêtres. Depuis chez moi, j’entends aussi les bateaux du port de Nice qui activent leurs sirènes. La première fois, j’ai eu la chair de poule. Les enfants du bâtiment à côté de chez moi crient: « Bravo les soignés! »
On reçoit des livraisons de viennoiseries, des pizzas, des chocolats mais aussi des fruits, une cafetière, de la crème pour les mains. Ça fait plaisir, on se sent chouchouté. Le self de l’hôpital a été fermé dès le début du confinement, et les services dits « Covid » sont livrés midi et soir en repas.
Mes congés prévus en avril sont déplacés. Mon vol pour Montréal est annulé. Je conserve quelques jours de repos pour début mai, et d’autres pour juin. Plus question de pont, de week-end, plus rien ne se passe normalement. Je reporte le restant de mes jours de vacances en septembre.
Le soir, on appelle un peu la famille, quelques amis, on s’inquiète, mais très vite, je sature des coups de fil où l’on ne me parle que du coronavirus, voire pire, on me demande mon avis: « toi qui es dans le médical… » Je ne suis pas médecin, ni pharmacien, ni épidémiologiste, et ne sais pas quoi penser de ce qu’on dit et entend. J’aurais tendance à être extrêmement prudente sur tout ce qui peut circuler dans les médias et à m’en remettre à des publications validées et reconnues, que je ne pourrais de toute façon pas évaluer correctement, n’étant pas experte! Exaspérée, je mets souvent mon téléphone en silencieux.
V, mon amie d’enfance infirmière en région parisienne, travaille en cancérologie: le service a été fermé et tous les patients évacués, contaminés par une infirmière du service. Mais aucun membre du personnel n’a été testé à ce moment-là. Elle est transférée dans un autre service pour aider, elle fait des heures sans compter, elle est épuisée. Elle échappera à la contamination jusqu’en octobre, où elle fait une forme asymptomatique, suite à un cas contact sur son lieu de travail.
Je fais des courses une fois par semaine. J’utilise une fois mon attestation de l’hôpital pour ne pas faire la queue au supermarché, mais je ne me sens pas à l’aise. Je ne le ferai plus, j’irai dans de plus petits commerces pour éviter la foule et l’attente.
En avril, un représentant fait le tour du labo avec A, il vient présenter une nouvelle technique de PCR chinoise, nommée « Sansure ». Sur le moment, je n’ai pas l’orthographe, et j’entends « censure », j’ai un fou-rire.
On a aussi un test rapide dédié au Covid-19, réservé aux urgences, à effectuer à la demande du biologiste. Un peu plus tard, une version de test rapide multiplex respiratoire incluant le Covid-19 sera commercialisée et utilisée au laboratoire.
G dessine le virus sur une grande feuille buvard dans le L3, des virus et des bonhommes autour qui l’attaquent, à la façon de « Il était une fois la vie ».
On trie les écouvillons positifs toutes les semaines pour les aliquoter et les congeler, en vue de recherche ultérieure. Je regarde ces aliquots en pensant à toutes ses vies qui basculent.
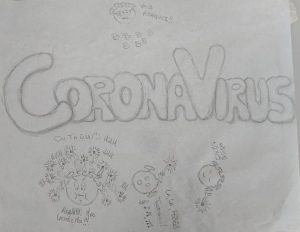
Depuis peu on reçoit des bulletins épidémiologiques et points de situation Covid qui récapitulent le nombre de tests, de cas positifs, de décès, de taux d’occupation des lits en hospitalisation conventionnelle et en réanimation. Difficile de penser à autre chose, quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise, où qu’on tourne le regard, on est martelé par le Covid-19.
Je ne sais plus quand exactement est arrivé un automate d’extraction supplémentaire (avril, mai?), car on a du mal à tourner avec nos deux déjà en place, les techniques de routine sont décalées pour permettre le passage de toutes les séries de virologie et de parasitologie. On a eu très peur des pannes, d’autant que les automates sont sur-sollicités, la cadence est montée jusqu’à quatorze séries d’extractions par jour (au lieu de deux à trois par jour en temps normal).
En parallèle la nouvelle technique « Sansure » est mise au point et passe en routine.
Un soir où je termine à 17h, il y a une arrivée fantastique de prélèvements, et je pars en laissant mes deux collègues prévus pour le soir, M et T, un peu effarés par ce qui leur tombe dessus. J’apprends le lendemain matin qu’ils sont partis à 1h30 pour arriver à tout terminer. Les plannings sont alors modifiés immédiatement pour qu’une troisième personne soit prévue sur l’horaire de soir. Une de mes collègues assure la soirée au pied levé, faisant une journée de 16h en continu.
Avec le yoga, beaucoup de respiration. Je suis surprise un matin en effectuant mes exercices, alors que je ne pensais à rien de particulier, les larmes viennent, et c’est alors un immense chagrin qui se déverse, pendant toute la séance (que je poursuis avec des mouchoirs en papier).
Quatre semaines après le début du confinement, je ne suis pas sortie, excepté pour aller travailler et effectuer quelques courses alimentaires. Cela commence à me peser, il fait très beau dehors, j’aurais besoin de respirer, de regarder le ciel, mais je culpabilise. Je me dis que j’ai de la chance de travailler, de voir du monde, d’avoir des journées bien remplies, je laisse les sorties à ceux qui n’ont rien d’autre. Mais un matin sur le trajet de l’hôpital, en empruntant la sortie de la voie rapide, les larmes viennent brutalement. Je respire fort et me calme, je veux sourire à mes collègues. Je suis quelqu’un de sensible, et de fort. J’encaisse, et je le sais. Je sais aussi qu’il faut tenir compte de ces manifestations-là et s’en occuper tout de suite: j’en parle à P, ma collègue ce matin-là, qui me déculpabilise. Elle me conseille de sortir marcher dans mon quartier, me convainc que cela ne fera de mal à personne, bien au contraire. J’écoute son conseil le soir-même et tous les jours après cela: 1h de marche chaque jour, ça aura tout changé.
Je prends parfois une chaise longue que je descends dans la cour intérieure de l’immeuble, où je prends un café avec F, mon voisin, quand je suis là l’après-midi, car le printemps est superbe.
Dernière semaine d’avril, je remarque que les rougeurs initiales apparues sur mes joues du fait du port prolongé du masque deviennent brunes, comme une pigmentation. Confirmation du diagnostic par le dermatologue 9 mois plus tard, et les tâches se sont étalées: humidité et frottement. Il faudrait ne plus porter de masque pour que cela s’estompe. Mais on ne peut pas.
Je lis beaucoup pendant mes temps de repos, je commence à écrire le récit de mon voyage de 6 mois en Amérique du sud en 2010. Cela fait 10 ans en mars que j’ai voyagé dans 8 pays sac sur le dos, impensable 10 ans plus tard, où on doit justifier par une attestation la moindre sortie.
Dehors il règne un calme étrange. Calogéro en fait une chanson. Presque personne sur la voie rapide, je n’ai jamais vu ça. Je ne serai jamais contrôlée par la police, même en rentrant à minuit.
Au niveau du rond-point d’accès à l’hôpital de l’Archet, un panneau d’encouragement pour les soignants a été placé bien en vue. On reçoit des dessins des enfants des écoles.
Un soir d’avril, vers 18h30, on reçoit 450 prélèvements en provenance de plusieurs EHPAD. On forme des groupes et on s’y met tous: on trie, on vérifie les bons, on tente de lire à travers les sachets triple emballage les noms des patients pour vérifier qu’on les retrouve tous et qu’il n’y a pas d’erreur. On classe les paquets par EHPAD. J nous montre comment enregistrer, on est 3 à s’y mettre en simultané. À 21h, tout est enregistré et une partie des prélèvements déjà pris en charge en pièce technique.
Début mai, une de nos cadres est soudainement arrêtée. On ne sait pas ce qui lui arrive mais on est surpris: toujours souriante et réactive, on n’a rien vu venir. Elle ne reprendra que fin septembre, et dans un autre service.
On n’a plus de surblouses, l’approvisionnement en gants est tendu, les FFP2 ne sont plus nécessaires dans le L3, on peut se contenter du masque chirurgical. On ne sait pas très bien quoi penser. Je vois arriver des blouses en tissu jaune délavé, les élastiques sont distendus, je plaisante: « ça servait aux poilus dans les tranchées ou bien c’est fait pour accoucher les vaches? »
Au labo, on rit beaucoup aussi. L’équipe est très diversifiée et solidaire, avec des personnels qui viennent de beaucoup d’autres services. Je fais des connaissances que j’apprécie énormément. Il y a beaucoup d’entraide, personne ne râle lorsque l’organisation change, lorsque les consignes sont modifiées, lorsqu’il faut refaire une plaque parce qu’il y a une contamination, un loupé. On fait tous des efforts, on plaisante. Le soir, on organise parfois des repas, le week-end, on apporte des petits déjeuners.
Je commence à avoir du mal à me reposer, l’hygiène de vie de sportif préparant une compétition me pèse, j’ai du mal à respecter mes temps de sommeil, les changements d’horaires tous les jours sont difficiles à encaisser. Et puis je passe beaucoup de temps au téléphone, avec mon compagnon au Canada, 6H de décalage horaire, je me couche tard pour lui parler. Je me réveille tôt le matin même quand je termine très tard la veille.
Le 11 mai, on est déconfinés. Je travaille en 16h-00h ce jour-là, alors le matin je sors marcher sur le mont Boron, fort du mont Alban, fort Thaon. Il a plu et le ciel est nuageux, il y a peu de monde. Je respire (un peu).
Je refuserai de recevoir chez moi, les invitations chez les autres, les fêtes, les anniversaires, les restos, les verres dans les cafés ou les bars, je ne prendrai personne en voiture pendant des mois. On se moque de moi, on me dit que je suis trop rigide, ou trop flippée. Certains me disent que c’est fini, qu’il faut profiter de la vie. Je ne supporte pas. Je ne veux voir personne. Si je sors pour faire une course, j’ignore les gens, je ne les regarde pas. Je ne supporte pas les commentaires, les masques sous le nez, sous la bouche, les gens qui se font la bise, qui parlent de vacances, de décompresser, je ne sais pas quoi, n’importe quoi. Je me dispute presque avec deux de mes amis au téléphone, tendue, agressive.
Courant mai, une équipe vient effectuer un reportage photo, et aussi une vidéo, pour illustrer le parcours d’un patient et de sa prise en charge. La vidéo sera projetée sur le bâtiment Pasteur 2 un peu plus tard.
L’activité décroît, certains personnels détachés en renfort commencent à regagner leurs services respectifs. Dehors il fait beau, il fait bon, les gens sortent, le masque n’est pas obligatoire. Je n’arrive pas vraiment à me détendre.
J’ai mon ami G au téléphone, il n’a pas mis un pied dehors pendant le confinement, et il n’a pas pu sortir la semaine qui a suivi le déconfinement, totalement paniqué, avec un sentiment de nostalgie du confinement. C’est un stress post-traumatique, c’est à prendre au sérieux. Il réagira peu de temps après et arrivera à reprendre une vie plus normale.
Début juin, je commence à exprimer ma baisse de moral, et les gens se mettent à parler. « Moi aussi », « J’ai donné un dimanche parce que je ne me sentais plus capable de tenir une pipette », « Je suis rentrée hier soir et j’ai pleuré ».
Je vais à la pharmacie et achète du magnésium et de la rhodiole pour 3 semaines.
Dimanche 21 juin au matin, la chef de service m’appelle: un des techniciens prévus de garde ne s’est pas présenté, il manque quelqu’un pour la journée. Je ne vois pas son message tout de suite, mon téléphone est en mode silencieux. J’ai travaillé toute la semaine, le samedi inclus, je suis fatiguée.
Je la rappelle dès que j’ai son message, elle a entre-temps contacté E qui s’est déplacé. Ce coup de fil me décide à contacter l’équipe de psychologues prévue en soutien aux équipes, dont les coordonnées sont affichées dans le laboratoire depuis avril. Cela fait deux semaines que j’y pense, je me sens moi-même triste et lasse, je me rends compte que nombre de mes collègues ne vont pas bien. Pleurs ou larmes aux yeux, fatigue, déprime. J’appelle cela le « corona blues ».
Le 1er juillet, j’apprends que le Canada ne rouvre pas ses frontières aux étrangers. Je me sens terriblement seule et triste. Je ne dors presque pas cette nuit-là. Je commence à 7h le lendemain et j’ai le cœur gros. Dans le couloir du laboratoire, il y a un tableau Velleda: je dessine une ligne de base et une échelle verticale que je gradue. L’intersection est à zéro et représente le sol. Au dessus, c’est positif, le soleil brille, au dessous, c’est négatif, ça broie du noir.
L’espace dédié au côté négatif est volontairement plus important que le côté positif, et je gradue: -10, -20, -30. Je fais une croix à -30 et écris mon nom. Je donne un titre « Solidarité du fond du trou, corona blues » et je note une question: « Et vous, où êtes-vous dans le trou aujourd’hui? » Dans le trou ou hors du trou? C’est mon dernier jour au laboratoire de virologie avant de regagner mon service d’affectation.
J’explique le concept à des collègues, ça crée une sorte d’émulation. Beaucoup participent et indiquent leur position dans le trou ou hors du trou. Beaucoup sont dans le trou. Je propose à ceux qui sont hors du trou d’aider ceux qui sont dedans. Les résultats sont étonnants.
Les psychologues viennent la semaine du 10/07. Je trouve ça tard, 3 semaines après mon message initial. Presque tous les agents présents viennent sur la terrasse où l’échange est initié avec les deux psychologues qui sont venus nous rencontrer. Déception, sentiment d’impuissance, d’abandon, de surdité face aux besoins de l’équipe (matériels, humains…). Cela semble faire du bien, certains sont tendus, les larmes aux yeux. Les psychologues nous disent qu’ils feront remonter nos doléances à la direction, on nous parle d’outils servant à mesurer le moral des troupes, de santé à préserver, on leur montre « le fond du trou ». Mais il ne se passera plus rien après ça.
Dans le hall de l’Archet 2, un immense panneau est installé depuis le mois de mai, « MERCI », où figure les prénoms des personnels monopolisés pendant la crise Covid.
Je réintègre mon service d’affectation le 3 juillet, mélancolique.
Dehors, une autre réalité se déroule: le masque n’est pas toujours porté rigoureusement, une certaine légèreté règne et cela m’insupporte. Les gens parlent de vacances ou de frustrations liées aux événements reportés, aux salles de sport fermées. Je prends sur moi comme je peux, mais j’ai du mal. Je fais des insomnies, me réveille très tôt, je me sens irritée, je pleure souvent.
Mi-juillet, le self de l’hôpital est rouvert. Je n’y retourne pas, je déjeune dehors, où je peux.
Je suis très anxieuse quant à la séparation forcée avec mon compagnon, je passe des soirées à lire les directives canadiennes et à chercher une brèche pour passer. Mais il n’y a pas de possibilité. Je pense « Peut-être qu’on ne va jamais se revoir? Peut être que je vais mourir là ou qu’il va mourir là-bas et qu’on ne pourra jamais se rejoindre? »
Je vais finalement consulter un médecin généraliste que je ne connais pas en juillet, je lui raconte l’histoire: les semaines au laboratoire, la visite tant espérée de mon compagnon envolée, le manque de perspective, l’angoisse, ma vie personnelle qui m’échappe entre les doigts. Je me sens épuisée, nerveusement et physiquement. Je suis en vacances dans 10 jours, je ne veux pas m’arrêter. Il me prescrit un somnifère et un anxiolytique. Je n’en prendrai que quelques fois, pour tenir jusqu’à mes vacances.
Les vacances me font du bien mais je ne suis pas vraiment sereine. En août, je demande le remboursement de mon vol. Je le rachèterai quand j’aurai de la visibilité. Je n’en ai toujours pas à ce jour, en mars 2021.
C’est l’été, il fait chaud, personne n’a envie de porter un masque, on a tous envie de passer à autre chose. Pourtant, les cas de Covid réapparaissent. Les horaires avaient été revus à la baisse en juin, fermeture à 21h, mais dès début août, il faut à nouveau rouvrir jusqu’à minuit. Les personnels prennent leurs congés, de nouveaux techniciens ont été recrutés. L’ensemble des membres de l’équipe technique de renfort a totalement été redéployée dans ses services d’affectation initiaux entre juin et juillet.
Le Covid semble loin dans l’esprit des vacanciers, j’entends une jeune femme interviewée dire qu’on lui vole sa jeunesse, qu’elle ne mettra pas de masque pendant « ses » vacances. C’est violent au fond de moi.
Vers la mi-août, j’apprends que le Canada prolonge ses restrictions d’entrée sur son territoire au 21 septembre. Mes vacances reportées en septembre se passent alors en France, en famille, mais je me sens terriblement triste.
Fin septembre, je suis rappelée pour revenir aider le laboratoire de virologie le week-end, j’accepte. Je fais un dimanche en octobre, puis un samedi et un dimanche en novembre.
Quand je reviens en octobre, il y a eu des changements, je passe un vendredi en technique avant le dimanche en question pour me mettre à jour. Ma collègue m’explique qu’il y a une rupture mondiale de plastique, donc certains consommables tels que les pointes à filtre dédiées à la biologie moléculaire sont en rupture d’approvisionnement, il faut les réserver à certains pipetages, réfléchir avant d’ouvrir une boîte pour ne pas les gaspiller. Je pense: et on n’est qu’en octobre!
Les références des surblouses, des gants, des écouvillons, des masques ont changé un nombre incroyable de fois depuis mars: entre rupture et nouvel approvisionnement, la tension sur ces équipements est mondiale.
Je pense à l’hiver qui approche et à ce qui risque de se passer, le froid arrivant et la vie plus casanière qu’en été. Les recherches sur le vaccin se poursuivent, on entend tout et n’importe quoi, j’écoute assez distraitement, sans expertise suffisante pour avoir une opinion sur les technologies mises en œuvre. Je reste néanmoins une convaincue du bienfait de la vaccination.
Je lis « Putain de Covid » de Védécé, qui, au 07/04/2020, proposait une attestation qui dit: « Je soussigné CONNASSE/CONNARD, qui malgré le confinement, sort de plus en plus sans respecter les mesures de sécurité, ME METTANT VOLONTAIREMENT EN DANGER, entraînant un effet rebond de l’épidémie et l’épuisement des soignants sur le front depuis un mois. EN TOUTE CONSCIENCE J’ASSUME LE FAIT QUE JE NE SERAI PAS RÉANIMÉ SI JE SUIS ATTEINT DE FORME SÉVÈRE DE COVID-19. »
Mon compagnon vient fin novembre, après 10 mois de séparation forcée. J’ai tellement peur qu’il y ait un problème au cours de son voyage que je ne dis rien à personne. Quand il me confirme être dans l’avion qui décolle pour Nice, je commence à pleurer, je pleure tout l’après-midi, jusqu’à son arrivée. Je n’ai plus beaucoup de jours de congés, mais au moins on peut se voir le soir, le week-end, et j’ai tout de même une semaine de repos à Noël.
Une semaine avant noël, je suis cas contact avec un médecin de mon service. J’attends 7 jours et je me fais tester: je suis surprise par la douleur que provoque le prélèvement, qui me fait saigner. Heureusement les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés, personne n’est contaminé dans le service. Je suis négative au test PCR et on passe Noël en famille, avec nos masques. On ne parle pas en mangeant, on remet le masque pour parler.
Là encore, je vois des images de gens partis à Dubaï pour célébrer la nouvelle année, qui font la fête. Colère et amertume.
Mon compagnon repart fin décembre, j’ai le cœur gros, j’ai si peur qu’on ne puisse à nouveau pas se revoir avant longtemps.
En janvier, la vaccination démarre au CHU de Nice. Les opinions sont très mitigées et beaucoup de personnes ne veulent pas se faire vacciner. Vais-je sans arrêt me disputer avec les autres?
Je suis vaccinée le 5 janvier, une fin de flacon à la médecine du travail, puis le 26 janvier, 2ème dose. Je suis soulagée, mais le nombre de cas augmente à nouveau, les variants font leur apparition et cela devient le nouveau sujet de prédilection des médias.
Un de mes voisins âgé est contaminé et meurt quelques jours après. De plus en plus de personnes de mon entourage sont touchées par la maladie.
Nice devient une zone écarlate, cramoisie même. Mon collègue S m’appelle un soir fin janvier, et me reparle de ce qui s’est passé le printemps dernier en virologie, « tu te rappelles, c’était Bagdad… » Je suis stupéfaite, ce n’est pas son genre.
Je lis que dans une tribune, Bernard-Henri Lévy dit à propos des masques que « l’éthique du visage se voit amputée », et la réaction de Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon, à Paris: « Qu’il vienne voir les personnes en réa, déformées par les machines, l’intubation scotchée sur la bouche, le cathéter dans le cou: on aura alors un débat sur l’éthique du visage. »
Je vais parfois déjeuner au laboratoire de virologie, l’équipe est au bout du rouleau. On n’en sort pas, on n’en voit pas le bout. La chef de service me dit: « Personne ne comprend ce qu’on vit ».
Et je vois bientôt des images circuler de la planète Mars. Le robot « Persévérance » s’est posé sur le sol martien et nous envoie des photos. La planète Mars? Faudrait-il ouvrir un hôpital public sur la planète Mars pour qu’un investissement massif ait enfin lieu? Et Mars, c’est aussi le mois qui célèbre tristement une année de pandémie. Persévérance, sur terre aussi.
Pour tout cela, pour encourager tous ceux et toutes celles qui ont ce sentiment de désarroi et d’absurdité, j’ai décidé de témoigner et de raconter. Et aussi pour soutenir une équipe que j’aime de tout mon cœur.
Glossaire:
PCR = Polymerase Chain Reaction
ASH = Agent de Service Hospitalier
L3 = Espace du laboratoire à atmosphère contrôlée (clos et en dépression), permettant le confinement des agents biologiques manipulés. L’entrée du personnel est effectuée via un sas avec portes asservies. Tous les L3 sont équipés de PSM (poste sécurité microbiologique) de type II et/ou de type III.
FFP2 = Masque de protection respiratoire adapté pour des environnements de travail dans lesquels l’air ambiant contient des agents toxiques et mutagènes.
EHPAD = Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Illustrations:
- P. Steinberg & D. Ho pour l’Innovative Genomics Institute
- Un membre de l’équipe d’Aurélie Calzia


