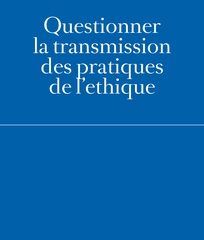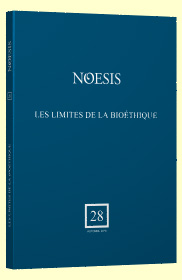 La bioéthique semble désormais assez consistante pour permettre – et suffisamment peu réflexive pour justifier – une approche épistémologique critique. Ce recueil se propose de mettre en place les conditions théoriques d’une réflexion méta-bioéthique (« méta- » étant plutôt ici à entendre au sens linguistique de dimension réflexive, qu’en un sens fondationnel). Ce projet ouvre plusieurs perspectives, que ce recueil ne fait qu’esquisser. Premièrement, une perspective historique et sociologique, qui a pour fonction de retracer l’instauration des pratiques de recherche hybrides subsumées sous l’appellation « bioéthique ». Dans quel contexte et face à quels problèmes la bioéthique est-elle apparue? Sont-ils toujours d’actualité? Est-ce une discipline, un courant, une mode, un espace de problèmes, une série disparate de thèmes? Deuxièmement, une perspective proprement épistémologique, qui interroge les méthodes, les enjeux, les fonctions de cette pratique de recherche, et expliciter ses présupposés théoriques inquestionnés. Quelle conception du vivant fonde la bioéthique? Comment comprendre que son champ occulte l’immense majorité du vivant (animaux, plantes, écosystèmes) que son nom englobe pourtant? Troisièmement, une perspective critique, qui a pour vocation d’évaluer conjointement les fondements de cette pratique théorique, le projet qu’elle se donne, et l’accomplissement effectif de ce projet. Le paradigme fondateur de la bioéthique est le « principisme » qui s’est donné pour but d’élaborer des principes minimaux universels transcendant les morales particulières des soignants. Que reste-t-il de ce projet discutable? Quel est son paradigme moral actuel
La bioéthique semble désormais assez consistante pour permettre – et suffisamment peu réflexive pour justifier – une approche épistémologique critique. Ce recueil se propose de mettre en place les conditions théoriques d’une réflexion méta-bioéthique (« méta- » étant plutôt ici à entendre au sens linguistique de dimension réflexive, qu’en un sens fondationnel). Ce projet ouvre plusieurs perspectives, que ce recueil ne fait qu’esquisser. Premièrement, une perspective historique et sociologique, qui a pour fonction de retracer l’instauration des pratiques de recherche hybrides subsumées sous l’appellation « bioéthique ». Dans quel contexte et face à quels problèmes la bioéthique est-elle apparue? Sont-ils toujours d’actualité? Est-ce une discipline, un courant, une mode, un espace de problèmes, une série disparate de thèmes? Deuxièmement, une perspective proprement épistémologique, qui interroge les méthodes, les enjeux, les fonctions de cette pratique de recherche, et expliciter ses présupposés théoriques inquestionnés. Quelle conception du vivant fonde la bioéthique? Comment comprendre que son champ occulte l’immense majorité du vivant (animaux, plantes, écosystèmes) que son nom englobe pourtant? Troisièmement, une perspective critique, qui a pour vocation d’évaluer conjointement les fondements de cette pratique théorique, le projet qu’elle se donne, et l’accomplissement effectif de ce projet. Le paradigme fondateur de la bioéthique est le « principisme » qui s’est donné pour but d’élaborer des principes minimaux universels transcendant les morales particulières des soignants. Que reste-t-il de ce projet discutable? Quel est son paradigme moral actuel
Actualité
Loi fin de vie: Olivier Falorni annonce le dépôt d’un nouveau texte à l’Assemblée nationale
Le projet de loi sur l’euthanasie et le suicide assisté était tombé avec la dissolution de l’Assemblée. Le dépôt de ce nouveau texte devrait être validé en début de semaine prochaine (Source: Le Figaro).